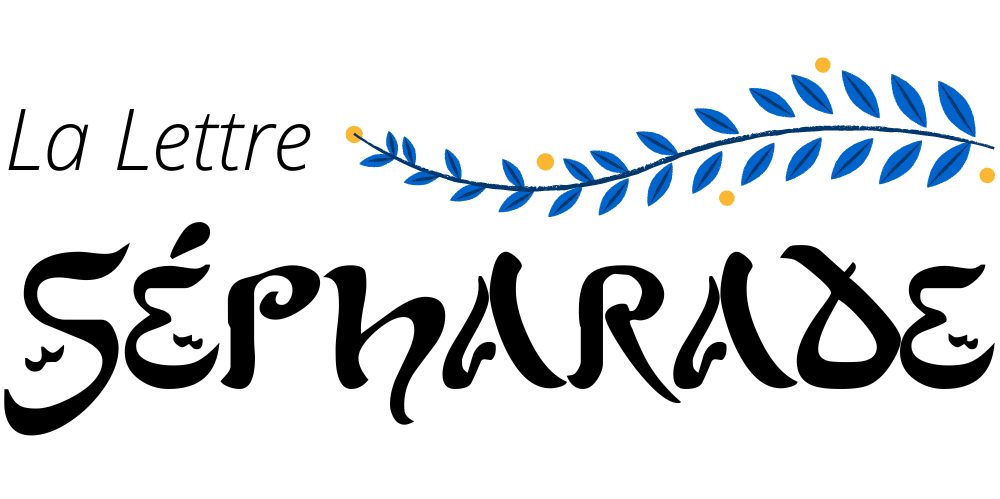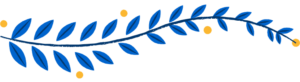Le festival Panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient aura lieu à Paris et en Seine-Saint-Denis jusqu’au 21 avril. Parmi les films projetés, Sho Qostak ?, un documentaire passionnant et intimiste de Pauline Carbonnier et Jamal Khalaile, sur ces deux faces complémentaires d’une même pièce : l’identité et l’altérité – en l’occurrence chez de jeunes Juifs israéliens. Documentaire minimaliste dans sa forme et qui donne matière à penser non seulement la question israélo-palestinienne, mais celle de l’identité et de l’adhésion à une mythologie collective, Sho Qostak ? a une portée qui dépasse son seul sujet, traité avec une approche neuve. Nous avons interviewé la co-réalisatrice du film, Pauline Carbonnier.
Un homme fuit cependant que, face à lui, l’horizon tombe si bas qu’il s’absente. Images de murs et d’autres murs encore, qui bouffent le ciel – murs que construisent des hommes comme Sisyphe pousse son rocher. Puis des routes perdues dans la nuit humaine et qui ne mènent, semble-t-il, nulle part… Des lieux abandonnés, lieux d’une mémoire colonisée par les végétations de l’oubli, attaquée par la rampante, végétale corrosion de l’Histoire, du silence de l’Histoire. Des maisons abandonnées, probablement en 1948, lors de la « Nakba » (exode massif des Arabes), des tunnels sans issue. À eux seuls, les plans de transition, métaphoriques, scandent la claustration, l’enfermement : et celui-ci, n’est pas seulement, comme pourraient trop facilement le croire beaucoup de militants manichéens, celui très concret et matériel des Palestiniens derrière le « Mur de Sécurité ». Il est, ici, celui des Israéliens mêmes – celui dont parlait d’ailleurs Sylvain Cypel, dans Les Emmurés. Derrière quels murs mentaux sont donc enfermés et corsetés jusqu’à l’étouffement les Juifs israéliens ? C’est ce dont il est question dans ce documentaire, co-réalisé par la Française Pauline Carbonnier et le Palestinien d’Israël Jamal Khalaile.
Dans L’homme approximatif (1931), Tristan Tzara écrivait : « qui pense à la chaleur que tisse la parole / autour de son noyau le rêve qu’on appelle nous ». C’est de cela qu’il s’agit, puisque au centre du dispositif filmique de Sho Qostak ? est la parole de jeunes Israéliens réfléchissant sur les mythes nationaux, sur l’identité collective juive israélienne. Tandis que beaucoup de films sur le conflit israélo-palestinien, en dépit de leur vif intérêt, se montrent délibérément rationnels, comme si la Raison avait à elle seule le pouvoir de changer les êtres, Sho Qostak ? va à l’os du problème : la racine psychique, l’intériorisation d’une certaine histoire officielle, d’un certain récit national. Qu’ils les contestent ou qu’ils s’interrogent sur leurs croyances profondes, ils n’apparaissent pas comme des salauds, mais au contraire provoquent cette troublante impression d’avoir affaire à des êtres complexes et doués d’une pensée rationnelle.
Il est beaucoup question de peur, de méconnaissance de l’Autre (« le Palestinien », en l’occurrence), de mémoire manipulée, du caractère central de l’armée (« Tsahal ») dans la nation israélienne. À travers les récits des uns et des autres, l’Autre, totalement inconnu, semble fantasmé comme essentiellement menaçant : pour l’individu même, pour les Juifs, pour la nation israélienne et l’identité juive d’Israël. Comment définir une identité sans admettre l’altérité, lorsque l’Autre n’est essentiellement qu’une construction imaginaire ? Ainsi interroge Sho Qostak ?, mettant à nu un profond trouble identitaire ressenti par une partie des Israéliens. Au profit d’une histoire officielle israélienne et de l’annexion de la judéité par le sionisme, ce sont les identités historiques juives dans leur diversité, soit autant de repères structurants, qui sont niés. Et il semble, précisément, qu’Israël ne saurait se passer de ses mythes – et mensonges – fondateurs, sans quoi, selon toute vraisemblance, le pays s’effondrerait sur lui-même. La question identitaire en Israël est, au fond, la faiblesse qui se donne de faux airs de force.
Il n’existe pas d’amour possible sans reconnaître sa vulnérabilité propre, son incomplétude, pas d’amour sans le renoncement à cacher son orgueil sous son torse bombé. La reconnaissance de sa vulnérabilité est force d’âme, force d’humanité. Or, c’est de cette vulnérabilité, du fait d’accepter que l’Autre peut nous changer, que peut naître l’amour et un rapport pacifié ou assaini à autrui, donc au monde – sans faux-semblants de torse bombé. En Israël, d’une façon sans doute plus outrée qu’ailleurs, cette vulnérabilité n’est pas admise : l’identité se crispe sur des mythes, se cache par peur de changer, de s’ouvrir, sous la mythologie viriliste et martiale de sa supériorité. Et c’est, de fait, par une diffuse psychose paranoïaque de masse, une déperdition du sens d’autrui que s’endolorit l’identité israélienne présente et, par tâche d’encre, une certaine identité juive dominante, acquise au sionisme. C’est cela qu’incarne d’ailleurs la jeune femme-colon du Gush Katif : un certain fanatisme du sentiment d’invulnérabilité, qui n’est que le revers du sentiment profond de sa faiblesse, de son impuissance. Qui se sent fort et sûr dans son identité ne saurait se sentir le devoir de la prouver et l’imposer par la brutalité ou l’arrogance.
La parole la plus passionnante et peut-être la plus centrale vient d’Oded (ci-dessus), un jeune homme libéral probablement de Tel-Aviv, profond, réfléchi… et réflexif. Conscient de sa position, de qui il est, de son parcours, il incarne ce qu’un intellectuel ne devrait se passer d’être aujourd’hui : quelqu’un de conscient de soi, quelqu’un qui d’abord se perçoit comme symptôme et commence à analyser le monde en s’analysant et vice-versa. Lucide, presque douloureusement, il renforce le contraste de la parole de sionistes fanatiques, notamment celui de le jeune femme du Gush Katif qui parle de « raison »… ou le doux fou de Dieu, infiniment touchant par son regard pétillant de grand gosse, dont l’ingénuité infantile dit le conditionnement de son environnement religieux. « Écoutons-les », invite le documentaire ; « regardez, écoutez : ils ne sont pas les monstres abjects que vous croyez ». De fait, nous voilà face au visage simple et ordinaire de la sottise humaine, celle d’individus qui sont parfois davantage des objets pensés que des sujets pensants. Certains apparaissent comme de véritables pantins interchangeables, récitant avec la conviction de ceux qui se croient uniques, les mêmes sottises, les mêmes mythes que répéteraient avec une semblable conviction des centaines, des milliers, des millions d’autres.
Et cependant, il reste la flamme du doute, de la capacité à douter de soi, à interroger ses certitudes. Cela se fait parfois dans la douleur, parfois de façon emportée : l’un des mérites majeurs – et que gagneraient à méditer bien des militants – réside dans cette maïeutique, dans ce patient processus d’accompagnement du questionnement personnel.
Au bout du compte, comme l’écrivait le poète Attila Jozsef, que la voix de Bertrand Cantat a contribué à faire connaître, « C’est en vain que tu plonges ton visage en toi-même / Tu ne pourras jamais le laver que dans l’Autre ». Tel est bien l’enjeu – en Israël comme ailleurs. Et cela ne vaut pas que pour les intervenants du documentaire mais aussi – et cela est infiniment plus intéressant – pour les spectateurs mêmes.
Les films sur Israël ou les Israéliens, la Palestine ou les Palestiniens, sur le conflit israélo-palestinien, ne manquent pas. Pourquoi donc vouloir réaliser un film sur cette zone ? Qu’est-ce que Sho Qostak ? apporte de neuf à la réflexion sur le sujet ? Comment a émergé l’idée du film, comment a-t-elle évolué jusqu’à son achèvement ?
La question de départ de ce film, celle qui nous a poussés Jamal Khalaile (en tant que palestinien d’Israël) et moi (française) à venir entendre et filmer des citoyens juifs israéliens issus de courants idéologiques différents (des antisionistes aux colons religieux fanatiques), réside dans cette question : « Comment voir l’Autre ? » et dans le désir d’initier un dialogue de façon à provoquer un questionnement. L’« Autre », qu’il soit israélien ou palestinien, selon le point de vue, est très souvent réduit à une entité stéréotypée, perçue spontanément comme inquiétante, fourbe, suspecte. L’idée était que Jamal aille interroger ceux qui représentent l’Autre, en l’occurrence le « dominant », rencontré par hasard, sans le connaître encore, et sans qu’il le connaisse, afin de comprendre quel est son conflit intime, quel problème il a avec son histoire, et de voir comment il s’approprie l’Histoire – et laquelle, quel récit. Le film traite au départ de cette rencontre : la rencontre avec l’Autre, le « dominant ». Il vient du désir de prendre le temps d’écouter une parole qui se déploie.
Jamal est le personnage structurant du film parce qu’il va déclencher la parole des différents personnages, en espérant que de ces rencontres émergent des questionnements personnels. L’idée n’était pas de venir avec la caméra pour susciter chez les Juifs israéliens ce que tout, en Israël, invite à être face à un Palestinien. Il n’était pas question d’en venir au fameux thème récurrent « Nous » et « Eux », au « Nous sommes différents d’eux », mais de justement pousser chacun à sortir du cadre mental dans lequel il se trouve ou dans lequel on l’a placé. Et cela sans prise de position morale, sans réduire chacun à une figure de bourreau, alors même que, eu égard à la situation, il serait facile d’aller dans ce sens. L’idée de départ partait du désir de comprendre ce qui pose problème aux différents intervenants, ce qui les meut – ce qui, en somme, nous meut tous : l’espoir, la colère, l’amour, la peur, etc. – et exposer leur vision d’un État exclusivement juif ou non, leur rapport à l’Autre, leur peur… bref, le mal-être de deux catégories d’êtres aux antipodes : l’antisioniste et le religieux fanatique qui vit dans les territoires occupés.
Ainsi, différentes visions se succèdent. Les uns, aux convictions antisionistes, prônent un Israël débarrassé du poids de l’ethnicisme et où État et religion seraient réellement séparés. S’exprime chez eux une vision d’un Israël entré dans la conception moderne de l’État, ou plus exactement de la nationalité, où les citoyens juifs le seront parce qu’ils auront choisi de l’être comme bon leur semble et de vivre avec des non-juifs, c’est-à-dire d’une manière très différente les uns des autres, et non parce que la « nature ethnique juive » de leur État y est imposée par le rabbinat orthodoxe.
Ces interviews frontales, qui très vite deviennent comme des récits en soi, dépassent le simple propos informatif pour faire pénétrer des réalités singulières qui sont autant d’instants d’une même réflexion. Cependant, la narration du film s’appuie sur des plans de transition de lieux visités par la caméra sur fond de voix off en arabe. Celle-ci exprime le point de vue du Palestinien ou de l’« entité Arabe ». Ces lieux visités apportent un contraste avec l’image épurée de la salle blanche, la pièce silencieuse où prennent place les personnes interviewées.
Sur le plan formel, le film est minimaliste : peu de grands effets, des plans de transition lents et parfois déroutants, à portée métaphorique. Était-ce l’objectif ou bien des raisons expliquent-elles sa forme définitive, ou le fond (le film s’articulant autour des propos des quelques interviewés) posait-il une difficulté à penser la forme ?
Il était important de « conditionner », à l’aide d’un dispositif, celui ou celle que nous voulions entendre dans un espace hors de ses repères quotidiens, en le faisant asseoir dans un cadre totalement épuré, une pièce blanche. Aucun objet ou repère familier n’apparaît dans le cadre. La caméra les met ainsi à nu, d’une certaine manière. Ce que nous leur proposons n’est pas de les suivre dans leur vie quotidienne, de savoir ce qu’ils aiment, où ils vont de manière à savoir qui ils sont. Ce que nous leur proposons est plutôt de les situer dans une sorte de no man’s land, une pièce blanche, et d’y attribuer une dimension intemporelle. Le dispositif est tel qu’il ne reste dans cet espace que la personne interviewée avec Jamal. Là, se déroule un travail sur le temps et cet instant particulier de la suspension du regard qui abolit le particulier pour ouvrir au général.
Se succèdent aussi parallèlement des visuels de transition lents, à portée métaphorique ainsi qu’une voix off en arabe, faisant échos aux récits des 5 protagonistes. Elles incarnent quant à elles, tout ce qui n’appartient pas à l’« entité juive israélienne », à l’image des ces travailleurs palestiniens, qui semblent écouter le questionnement existentiel et les conflits personnels des « dominants » sans disposer de l’espace pour être entendus, car leur mémoire est confisquée. Leur histoire ne fait pas partie de l’histoire d’Israël, puisqu’ils sont considérés comme des citoyens de seconde zone. L’attente resurgit régulièrement tout au long du film, entre les séquences. Ainsi, d’un espace à l’autre, on repasse à chaque fois par des espaces d’indifférenciation : ce sont des lieux laissés à l’abandon et où seule la nature se manifeste, ou bien des travailleurs palestiniens à l’ouvrage mais qui ne parlent pas, des paysages dont la temporalité est distendue.
Les séquences symbolisant l’errance (notamment les plans de cette silhouette qui fuit) apportent un contrepoint au récit des intervenants, et contribue aussi à renforcer la singularité de chacun. Parce que la société israélienne cultive la distanciation vis-à-vis de son environnement arabe, dans la mesure où elle le nie, il était important d’adopter ce dispositif minimaliste et, dans ce cadre, un espace d’humanité de manière à ce que l’Autre existe, ou de manière à ce que s’ouvre une parole en dehors du politique.
Pourquoi le film s’intitule-t-il « Quelle est ton histoire ? » ?
Ce film insiste sur la différence de point de vue apportée par chacun, ce qui amène à constater une confusion intrinsèque à la société israélienne et illustre par là-même le labyrinthe moral dans lequel évolue tout Israélien, dans la manière de pouvoir appréhender son rapport à l’Autre. Le film esquisse ainsi, par touches, la vision d’un mode de fonctionnement mental pris au piège de ses propres contradictions : sensation d’enfermement, sensation de temps distendu… Petit à petit, les intervenants se trouvent au cœur d’un entrelacs de récits, de fantasmes, de possibles allant à l’encontre de l’idée univoque d’une nation réunissant les Juifs en une seule et même entité.
D’où le titre en Arabe Sho Qostak ? qui se traduirait en français par « C’est quoi ton histoire ?! », dans le sens aussi de « C’est quoi ton problème?! ». La notion d’histoire est visiblement un problème en effet. Ceci est, par ailleurs, tout aussi valable en Occident (à l’égard de ses minorités ou de son passé colonial). C’est celle qui est à l’origine, entre autres, du conflit entre les individus d’une manière générale. En effet, qu’est ce qui fait que je décide d’appartenir ou de m’identifier à telle histoire collective et pas une autre? Qu’est ce qui fait que telle histoire va bénéficier de l’intérêt et de l’adhésion d’une majorité – à savoir des « dominants » – ou non ? Parce que l’Histoire provoque des occultations en permanence, au détriment de certains.
Par exemple, l’Histoire, en Israël – et c’est un travers venu d’Europe – est racontée à partir du point de vue occidental, un point de vue juif occidental, en l’occurrence. Comme si les Juifs n’avaient qu’une histoire occidentale, alors qu’ils ont aussi une histoire dans le monde arabo-musulman, une histoire qui n’a pas vu Auschwitz. À cela se greffent les concepts qui constituent le dénominateur commun de tous les manuels scolaires : l’antisémitisme, la menace arabe et le droit historique des Juifs à « retourner » dans leur patrie. Les livres soumis à examen ne décrivent jamais les Palestiniens comme des êtres humains mais plutôt comme un problème. Ces mêmes manuels décrivent les Arabes comme des êtres primitifs, avec une mentalité clanique.
Avec ce film, nous sommes face à des personnes restituées dans la complexité de leurs idées, des personnes en majorité intelligentes, rationnelles. Ce qui fascine, c’est le caractère précisément rationnel, humain du fanatisme, de la négation d’autrui. La gauche reste encore trop souvent trop convaincue de ce que la Raison peut tout, de ce qu’il faut « conscientiser », « faire ouvrir les yeux », etc. Or, le problème ne vient pas d’un défaut de conscience ou de raison, mais de ce qu’on pourrait considérer comme une conscience distordue, une raison malade. Comment se fait-il que des personnes sensées, rationnelles, adultes, refusent de voir ? Comment se fait-il, par exemple, que chez celles-ci existe encore cette disposition, prodigieusement naïve, à croire au mythe fondateur de la fuite spontanée de plus de 700 000 Arabes en 1948 à l’appel de la Transjordanie, alors que les Nouveaux historiens en ont démontré empiriquement la fausseté ?
La question véritable est justement : « Qu’est ce qui fait que j’appartiens (ou décide d’appartenir ou de m’identifier) à telle histoire et pas une autre ? », ce qui bien évidemment détermine la manière personnelle de voir ou d’agir dans le présent.
Après, tout en étant rationnel, « adulte », ou sensé, on peut ne pas voir ou entendre. On décide consciemment ou inconsciemment de ne pas voir. Ainsi, bien des intellectuels français s’exprimant sur ces questions, sont a priori des êtres rationnels aussi, mais ce n’est pas pour autant qu’ils voient les réels problèmes de fond de l’État israélien. On voit souvent ce qui nous arrange, ce qui arrange le discours de la mémoire collective à laquelle on appartient ou adhère.
Cependant, il est aujourd’hui communément admis (du moins dans les institutions israéliennes, universitaires, etc.) que la « fuite » de 720 000 arabes en 1948 n’était pas spontanée. Du moins ce n’est plus un tabou.
Quelles leçons sur l’identité, sur la nation, sur le « faire société » ou le « vivre ensemble » peut-on tirer de ce documentaire ou, plus largement, de l’analyse d’Israël ? L’identité collective, c’est-à-dire l’appartenance à une communauté est-elle nécessairement une mythologie, donc un mensonge, qui conduit au fanatisme ?
Pas nécessairement. Tout dépend dans quel contexte géopolitique l’histoire de telle identité prend forme, de quels enjeux telle histoire dépend. Lorsqu’un pouvoir dominant un échiquier géopolitique conséquent se sert de sa mythologie pour justifier ses moyens, alors oui, cela conduit visiblement au fanatisme. Dans le cas d’Israël, pour forger une mémoire collective, il a fallu « effacer » les histoires singulières des différentes communautés juives venues notamment des pays orientaux, au profit de l’histoire juive ashkénaze.
L’histoire des juifs porte en elle le rôle de victime tout au long de son histoire. Le cas israélien est le témoignage d’une continuité, c’est-à-dire qu’il est le seul qui englobe à la fois les modes de justification coloniaux, raciaux et virilistes, la position de victimes et l’héritage européen du colonialisme du XIXe siècle. Impossible sans ce dernier de comprendre le postulat sioniste originel selon lequel la Palestine, terre promise selon l’imaginaire européocentriste de Theodor Herzl, était « une terre sans peuple pour un peuple sans terre ». Tout cela forme une continuité, depuis le XIXe siècle jusqu’à aujourd’hui : on se positionne du côté du Bien. L’identité israélienne, après la seconde Guerre Mondiale et le génocide, s’est forgée du côté du « Bien ». C’est l’Histoire du Bien, comme le sous-entend l’un des intervenants, Oded, car la victime, c’est forcément quelqu’un de bien. Le statut de victime n’est pas un droit d’oppression, or c’est ainsi que les Israéliens l’interprètent : « Puisque nous sommes les victimes, si nous faisons souffrir quelqu’un d’autre, nous faisons souffrir moins que nous avons nous-mêmes souffert, quoi qu’il arrive. Puisque nous constituons un standard sur l’échelle de la souffrance, il est possible de mesurer, de quantifier quelle est la souffrance palestinienne par rapport à la souffrance israélienne. À laquelle se surajoute la mémoire des guerres et des persécutions, de l’antisémitisme et du génocide ».
La persécution, le sentiment d’un danger de périr et de disparaître fondent le droit moral de l’État d’Israël. Le perception morale des Israéliens n’a rien à faire des commissions d’enquêtes, des tribunaux internationaux ou des recherches historiques. Elle relève de la conviction intime de ce qui est juste et injuste, bon ou mauvais. Certains disent que celui qui juge Israël doit d’abord bien connaître ce pays et comprendre qu’une grande partie de sa population vit selon des critères moraux. Mais de quels critères moraux parlons-nous?
En Israël comme ailleurs peut-être, le problème est-il la nation ou le récit dont elle est porteuse ?
Je crois que les deux sont problématiques. La nation, dans ce qu’elle est devenue, à savoir une société capitaliste, libérale à l’extrême, jouisseuse, très américanisée ou règnent la loi du plus fort et la notion du gain. La vision de l’Histoire est uniquement dogmatique, idéologisée, et la compréhension du monde est formatée par le capitalisme : consommation, centres commerciaux, etc. Cela, on ne le voit pas dans le cinéma israélien. Et puis, bien évidemment un récit de l’Histoire nationale fondée entre autre sur des mythes bibliques, sur la peur de l’extermination (la mémoire de la Shoah est un des piliers de l’anthropologie juive israélienne), la peur de se faire avoir et la guerre…
Je terminerai en citant cette phrase de Menahem Begin : « L’essence de la liberté est d’être libre de la peur, car la peur est une loi d’autant plus terrible qu’elle demeure cachée ».