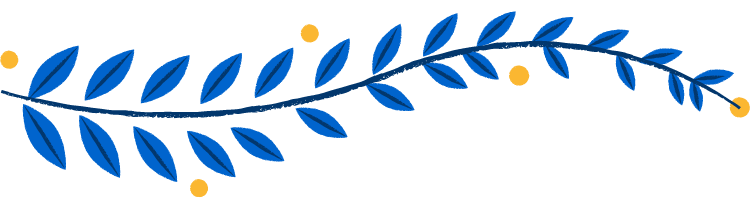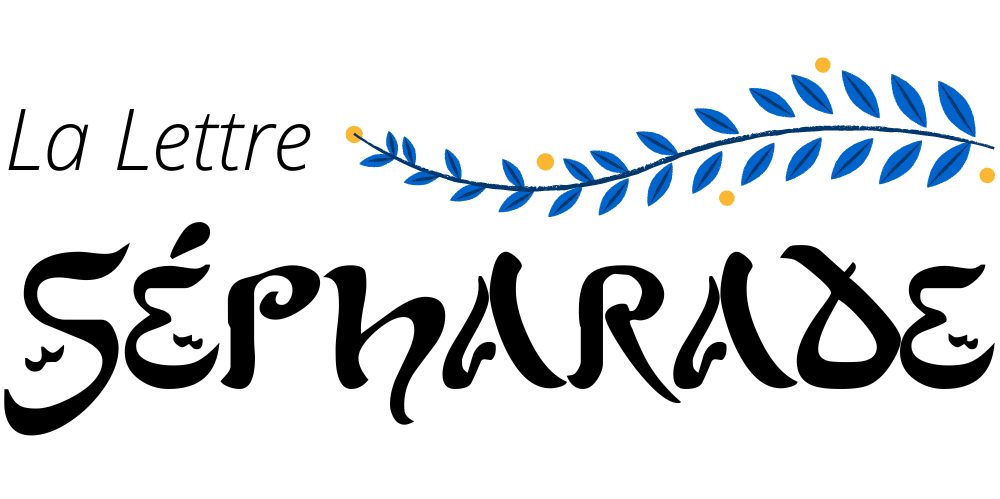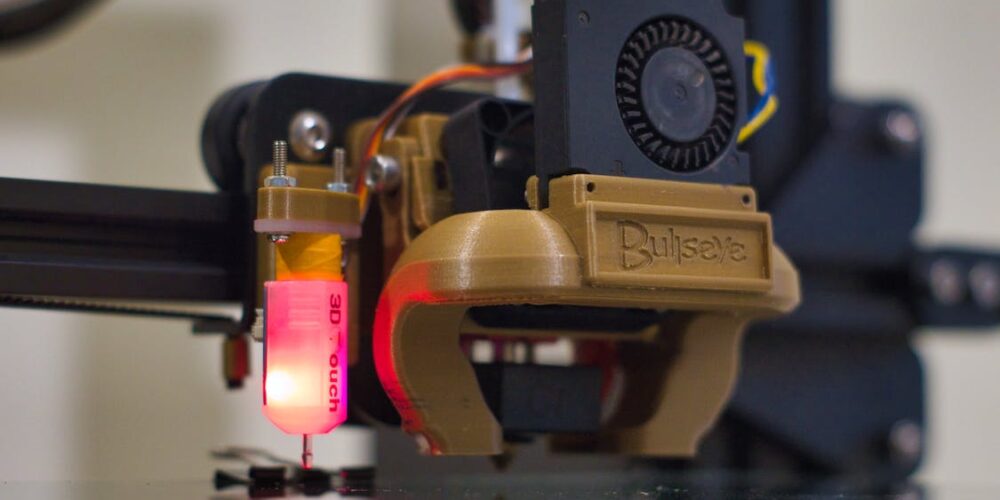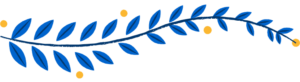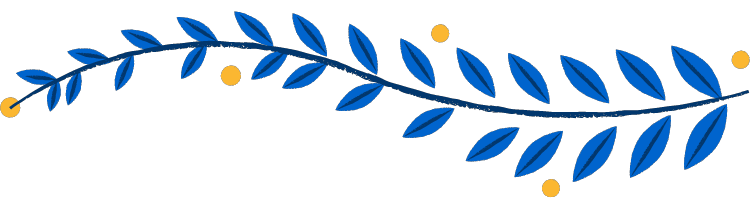 Actualités Juives
Actualités Juives 
Catégories
Articles à la une
Quels sont les sites les plus consultés en Israël ?
Chaque année, la société de technologie de l’information SIMILARWEB publie une liste des sites les plus consultés (selon les régions du monde). Grâce à cette…
L’entreprise israélienne objet a créé la technique PolyJet
Depuis sa naissance dans les laboratoires de recherche jusqu’à son…
Éclat et élégance : organiser une soirée d’entreprise mémorable à Paris
Paris, la Ville Lumière, offre un cadre magnifique pour organiser…